L’oeil du purgatoire, de Jacques Spitz
Quatrième de couverture :
Vous connaissez le passé, imaginez le futur, redoutez le présent: il vous reste à découvrir le « présent vieilli », ce temps inédit inventé par Jacques Spitz dans un roman phénoménal considéré comme un des classiques du roman d’anticipation français.
Son héros, un peintre raté résolu au suicide, va vivre une expérience hors du commun qui le conduira où nul n’est allé : inoculé par un savant fou, un bacille s’est attaqué à sa vue et lui permet de voir le monde et les êtres tels qu’ils seront dans un futur proche. Mais ce qui n’était qu’une étrange expérience devient une aventure effarante lorsqu’il réalise que le temps se dilate et qu’il «voit» de plus en plus en avant.
Livre haletant sur le cauchemar d’un homme seul au milieu d’un univers en déréliction, L’œil du purgatoire est un roman unique qui réussit à pousser une logique jusqu’à son extrême limite avec une audace et une intelligence qui ont laissé pantois ses admirateurs. Il était impensable de ne pas le proposer de nouveau à ceux qui croient que la littérature, mieux que n’importe quel art, doit nous permettre d’explorer les confins et les mystères de notre imaginaire.
Le présent vieilli ou la solitude de celui qui voit en avance
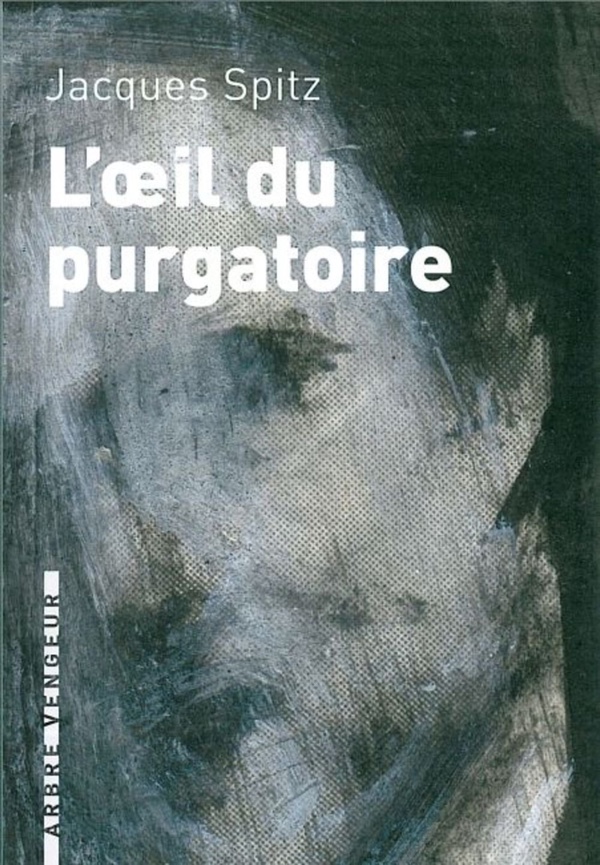 Quel étonnant roman que cet « Oeil du purgatoire » ! Roman court (moins de 200 pages, préface de Bernard Eschasseriaux (écrite en 1972 pour la sortie du roman dans la fameuse collection « Ailleurs et Demain » chez Robert Laffont) comprise), il offre pourtant au lecteur bien des facettes grâce à la belle plume de Jacques Spitz qui sait varier les styles pour donner différents plaisirs et niveaux de lecture.
Quel étonnant roman que cet « Oeil du purgatoire » ! Roman court (moins de 200 pages, préface de Bernard Eschasseriaux (écrite en 1972 pour la sortie du roman dans la fameuse collection « Ailleurs et Demain » chez Robert Laffont) comprise), il offre pourtant au lecteur bien des facettes grâce à la belle plume de Jacques Spitz qui sait varier les styles pour donner différents plaisirs et niveaux de lecture.
Le roman met en scène un peintre, Jean Poldonski, forcément génie incompris et qui impute son insuccès au monde qui l’entoure, aveugle à son talent. Il en nourrit une extrême amertume, une aigreur de tous les instants qui se transforme même en une ferme misanthropie. La manière dont Jacques Spitz introduit le personnage au lecteur est absolument délicieuse (façon de parler pour un misanthrope convaincu bien sûr…), et à ce titre le deuxième chapitre est une merveille de noirceur dans laquelle l’auteur fait feu de tout bois. C’est bien simple, on trouve des passages dignes de citation à toutes les pages ou presque. Ça frôle le génie ! Un régal de Tatie Danielle à la puissance mille ! Je ne résiste pas à vous livrer ici un petit florilège.
Par ailleurs, quand par miracle Poldonski, un brin bipolaire, parvient à voir la vie du bon côté, Jacques Spitz montre à nouveau l’aisance et l’élégance de sa plume, avec un champ lexical à peu près à l’exact opposé de ce qu’il développait quelques pages plus tôt. Mais cet état de bonheur béat n’est que de courte durée…
Poldonski, décidé à en finir avec une vie qui ne rime à rien dans ce monde qui ne le comprend pas, rencontre alors par hasard un autre homme persuadé de sa grandeur, Christian Dagerlöff. Ce dernier, voyant en Poldonski un homme sans attache, à l’écart du monde, déjà disposé à passer « de l’autre côté », vers le grand inconnu, décide de tester sur le peintre sa découverte incroyable : une bacille permettant de « voyager dans la causalité ». D’après lui, si un lapin sait s’enfuir avant même que le chasseur n’ait armé son fusil, c’est parce qu’il a vu le-dit chasseur le faire avant même que l’idée ne l’effleure. Il y a donc, du point de vue du chasseur, rupture de la causalité car le temps ne s’écoule pas de la même manière pour tous les êtres vivants. Il injecte donc à notre homme cette bacille, lui permettant de voir les choses avant qu’elles n’arrivent. Il ne s’agit pas, au sens strict du terme, d’un voyage dans le temps puisque cette bacille ne permet pas de voir l’avenir mais plutôt un « présent vieilli ». Ainsi, Poldonski ne voit pas ce qui arrivera dans le futur mais comment seront les choses dans ce futur. C’est une vision des choses et non des faits. En se baladant dans la rue, le peintre peut voir des cadavres car en voyant les choses avant qu’elle ne soient vraiment, il découvre que certaines personnes vont mourir dans peu de temps. De même, il finit par ne plus voir les fleurs mais des plantes mortes puisqu’elles seront rapidement fanées, etc…
Cette bacille, qui de plus, semble amener son sujet à prendre de plus en plus d’avance dans la causalité, finit pas montrer un monde et des corps en décrépitude, mettant à bas les apparences pour montrer l’être humain tel qu’il est vraiment : un amas de chair qui finit inéluctablement en décomposition, quelles que soient les classes sociales. Après tout, tout le monde finit à l’état de squelette, avant de redevenir poussière…
Et de roman où l’extrême misanthropie de son personnage principal lui donne un savoureux humour noir, « L’oeil du purgatoire » vire au roman philosophique sur le sens de la vie au cours de la fuite en avant de Poldonski. Regrets, amertume, et solitude d’un être que sa vision détache de plus en plus du monde réel, Jacques Spitz n’épargne rien à Poldonski qui quelque part voit son souhait être exaucé : quitter un monde qui ne voit pas le Beau. Problème : avec tout ce délabrement et cette déchéance généralisée qui l’entoure, le Beau n’existe plus pour lui non plus… Et sous la savoureuse et belle plume de Jacques Spitz (qui a incontestablement le sens de la formule et du mot juste), l’humour fait place à la mélancolie puis aux visions surréalistes et macabres (tel un squelette cul-de-jatte qui semble flotter puisque dans un avenir lointain, les os de ses jambes auront disparu avant le reste…).
Prenant sa source dans le merveilleux-scientifique de Maurice Renard, « L’oeil du purgatoire » pousse le raisonnement et la logique jusqu’à son point ultime, faisant de son roman une petite perle de noirceur, d’une remarquable lucidité sur le genre humain. On ne pourra certes pas y trouver un grand optimisme quant à notre nature profonde, mais pourtant, grâce (j’insiste lourdement, mais c’est un point tellement important du roman) à la plume gracile de Jacques Spitz, jamais le roman ne fait dans la lourdeur ou le pensum philosophique. Régal de tous les instants, « L’oeil du purgatoire » et sa noirceur relevant d’un art de vivre méritent bien plus qu’un simple coup… d’oeil (!!), et il faut sans aucun doute remercier les éditions de L’Arbre Vengeur pour avoir remis en avant, avec des illustrations d’Olivier Bramanti, ce roman méconnu (qui bénéficiera d’ailleurs très prochainement d’une nouvelle réédition dans la collection à petit prix de « L’arbuste véhément ») d’un auteur décédé en 1963 que je suis maintenant bien décidé à découvrir plus avant. Mieux vaut tard que jamais !
Lire aussi les avis de Culture-SF, B1p, ArchéoSF, Touchez mon blog Monseigneur, Cécile, Nomic, Simatural.


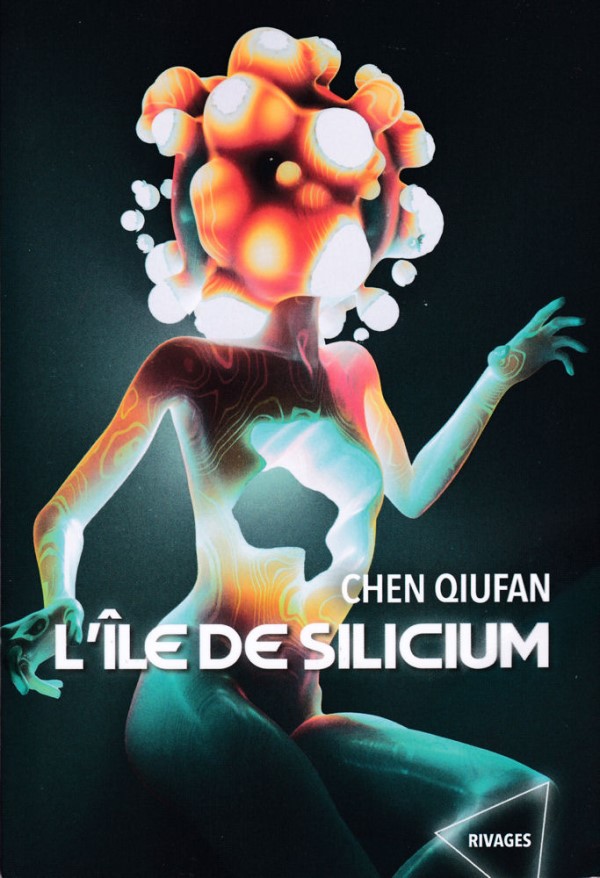
J’ai déjà lu mon roman misanthrope de l’année, ça me suffira, mais c’est toujours intéressant à connaître, merci pour cette découverte archéolivresque !
Quand c’est bien écrit, la misanthropie est un vrai plaisir. 😀
De rien ! 😉
Joli article qui donne envie. J’ai croisé son nom sans jamais l’avoir lu (il me semble que Moebius a réalisé une couverture pour un de ses ouvrages).
Merci. 😉
Après vérification, Moebius a en effet réalisé la couverture de « L’agonie du globe », bien vu. 😉
En tout cas, l’auteur mérite vraiment de ne pas être oublié.
Je mets le lien vers la couv en question https://images.noosfere.org/couv/s/septimus01-1977.jpg
Pour les amateurs de Moebius, on remarquera que ce dernier a utilisé son personnage du Major Grubert pour l’illustration, ce qui est assez étonnant. Au vu du titre, j’ai toujours cru que c’était un bouquin consacré à la cause écologique 🙂
Merci pour ces infos. Le pitch du roman « L’agonie du globe » est étonnant (la Terre a été séparée en deux hémisphères distinct, l’un avec l’Ancien Monde, l’autre avec le Nouveau), et en effet pas du tout écologique, mais il ne manque pas d’intérêt… 😉
Ça fait plaisir de constater que cette petite perle ne tombe pas dans l’oubli et continue à se tailler une réputation ! De Spitz, La guerre des mouches et L’homme élastique sont du même niveau.
Héhé, il me semble bien d’ailleurs que c’est grâce à tes articles que j’avais noté le nom de Jacques Spitz, il y a pas mal de temps déjà. Donc merci à toi. 😉
Si ceux que tu cites sont de même niveau, pas de raison de se priver !
Et je suis tenté de rajouter « La parcelle Z » et « Les évadés de l’an 4000 » à la liste de Nomic.
(Merci pour le lien)
Alors je les rajoute dans la liste des titres à surveiller, s’ils croisent mon chemin un de ces jours, merci. 😉
Et de rien ! 🙂
Le roman semble être intéressant mais son côté misanthrope me fait clairement passer mon tour, je ne pense pas que ça soit pour moi !
Ce n’est qu’un aspect du roman, ça passe ensuite à un autre niveau. Et c’est tellement bien écrit que ça reste à voir, même si je comprends que tu puisses ne pas aimer ce genre de sentiments. 😉
Super intéressant. À garder dans un coin de sa tête!
Oh que oui. Et surtout à lire aussi. 😀