La cité de l’orque, de Sam J. Miller
Quatrième de couverture :
22ème siècle.
Les bouleversements climatiques ont englouti une bonne partie des zones côtières. New York est tombé ; les États-Unis ont suivi. Au large de pays plongés dans le chaos, ou en voie de désertification, de nombreuses cités flottantes ont vu le jour. Régies par des actionnaires, elles abritent des millions de réfugiés.
C’est sur Qaanaaq, l’une de ces immenses plateformes surpeuplées, qu’arrive un jour, par bateau, une étrange guerrière inuit. Elle est accompagnée d’un ours polaire et suivie, en mer, par une orque. Qui est-elle ? Est-elle venue ici pour se venger ? Sauver un être qui lui serait cher ?
Waterworld au-delà du cercle arctique
 22ème siècle (oui je paraphrase la quatrième de couverture si je veux ! 😀 ). Les eaux sont montés, les crises et les guerres ont fleuri un peu partout, les gouvernements sont tombés, les réfugiés climatiques se sont déplacés en masse, etc… C’est dans ce contexte réjouissant que sont apparus quelques villes flottantes, modeste et illusoire bouée de sauvetage d’une humanité sur le déclin. Qaanaaq est l’une d’elle. Située entre L’Islande et le Groenland, elle est bâtie sur une source géothermale lui donnant l’énergie dont elle a besoin pour la survie de ses habitants. Dotée de huit bras reliés à une partie centrale, Qaanaaq abrite une population variée, les plus riches habitant le Bras 1, tandis que les plus pauvres (les plus nombreux) s’entassent dans un Bras 8 surpeuplé. Il y fait froid, humide, les conditions de vie sont rudes. Nettement moins dans le Bras 1 bien sûr, les plus aisés disposant de ce qu’il faut pour vivre à l’abri des difficultés.
22ème siècle (oui je paraphrase la quatrième de couverture si je veux ! 😀 ). Les eaux sont montés, les crises et les guerres ont fleuri un peu partout, les gouvernements sont tombés, les réfugiés climatiques se sont déplacés en masse, etc… C’est dans ce contexte réjouissant que sont apparus quelques villes flottantes, modeste et illusoire bouée de sauvetage d’une humanité sur le déclin. Qaanaaq est l’une d’elle. Située entre L’Islande et le Groenland, elle est bâtie sur une source géothermale lui donnant l’énergie dont elle a besoin pour la survie de ses habitants. Dotée de huit bras reliés à une partie centrale, Qaanaaq abrite une population variée, les plus riches habitant le Bras 1, tandis que les plus pauvres (les plus nombreux) s’entassent dans un Bras 8 surpeuplé. Il y fait froid, humide, les conditions de vie sont rudes. Nettement moins dans le Bras 1 bien sûr, les plus aisés disposant de ce qu’il faut pour vivre à l’abri des difficultés.
Construite par des intérêts privés, la ville entière est à la solde de ses actionnaires, qui fixent le prix des loyers en plus de faire la pluie et le beau temps sur un tas d’autres éléments. Pas de gouvernement ici, la ville est gérée (en plus des actionnaires bien sûr, qui agissent dans l’ombre et ne se montrent jamais) par un réseau d’intelligences artificielles chargées de s’occuper des affaires courantes de manière automatique et surtout totalement déshumanisée. Seuls les gestionnaires des Bras (un pour chaque Bras, accompagné de son équipe) donne une apparence d’humanité (mais ils ont en pratique très peu de pouvoir) à une complète automatisation inhumaine. Tout cela sonne donc très cyberpunk, à la différence près que l’aspect informatique/matrice est absent du récit (mais les connexions informatiques bien présentes malgré tout). Mais pour ce qui est de la prépondérance des intérêts privés sur ceux de la population, on est en plein dedans.
Sam J. Miller a soigné son background, cela se sent, Qaanaaq pue, Qaanaaq vit, Qaanaaq vibre, Qaanaaq est dangereuse, Qaanaaq est pourtant l’un des derniers refuges d’une humanité au bord du gouffre mais dont la partie la plus aisée continue de vivre en écrasant les plus faibles, au mépris du salut de l’espèce. C’est le gros point fort du roman, Qaanaaq a quelque chose d’à la fois fabuleux et repoussant. On y suit les affaires de plusieurs personnages dont les liens, au fil d’une narration très maîtrisée, apparaîtront petit à petit. De la représentante de la gestionnaire du Bras 7 (Ankit) à son frère lutteur-looser qui se cherche une vie (Kaev), en passant par une des maîtresses de la pègre locale (Go), un riche descendant (et victime d’une étrange maladie qui se propage à tous les étages de la population, métaphore du SIDA) d’un actionnaire de la ville (Fill), mais aussi un jeune livreur qui souhaiterait rejoindre l’organisation de Go (Soq), tous sont liés d’une manière ou d’une autre. La découverte de ces liens, très progressive, est l’un des moteurs de l’intrigue.
Et puis il y a cette femme arrivée dans la ville accompagnée d’un ours et d’une orque. Une femme qui détonne tellement dans le décor qu’elle en devient presque légendaire au fil des déformations qu’implique un bouche-à-oreille fasciné par ce personnage incongru, à la fois inquiétant et, peut-être prophétique. Tout ces personnages ont un lien particulier avec Qaanaaq, amour et haine tout à la fois. Si on ajoute à tout cela une sorte de podcast « underground » dont l’auteur est inconnu (intitulé « La ville sans plan »), on obtient un nouveau niveau de mystère et de complexité d’un worldbuilding qui force le respect.
Un background touffu donc, une narration alternant entre les différents personnages pour dévoiler progressivement les liens les unissant (c’est d’ailleurs un des thèmes centraux du récit), le tout autour d’une femme mystérieuse aux buts inconnus, un texte qui parle ouvertement de notre monde actuel (récit annonciateur ou dénonciateur, dans les deux cas nous sommes mal barrés…) en touchant des thématiques sociales, sociétales, communautaires, écologiques, sanitaires, déclin du politique au profit des intérêts privés, déshumanisation de la gestion socio-économique, éthique des recherches génétiques, roman devant autant à « Bladerunner » (le film plus que le roman, quoique…) qu’aux « Monades urbaines » de Robert Silverberg, avec une pincée de « Waterworld » à la sauce cyberpunk, « La cité de l’orque » est un roman montrant le monde, qui a déjà sombré d’une certaine manière (voire d’une manière certaine…), à nouveau sur le point de basculer. L’équilibre précaire va ici voler en éclat avec l’arrivée de cette femme et de ses animaux, amenant les personnages du récit à prendre les choses en main pour au moins survivre, et peut-être un peu plus…
Tout juste pourra-t-on regretter un roman qui se perd parfois à force de courir plusieurs lièvres thématiques à la fois, une intrigue qui devient un peu lâche ici ou là, ou un choix de langue encore une fois délicat à faire passer en français (Soq est désigné par « they » en VO, et il s’agit du « they singulier », qui n’a pas d’équivalent en français, on se retrouve donc avec un Soq désigné par le pronom « ils »… Difficile de trouver mieux sans doute (encore que des pronoms non-genrés commencent à faire leur apparition, tels « iels » alors que le choix de traduction utilise systématiquement le pluriel masculin), mais…) mais avec sa conclusion douce-amère on tient là un roman ambitieux tirant la sonnette d’alarme sur notre monde actuel. Sans aller jusqu’à le qualifier de grand chef d’oeuvre, « La cité de l’orque » (et son auteur Sam J. Miller) appuient clairement là où ça fait mal, et effectivement… Ça fait mal !
Lire aussi les avis de Gromovar, Lune, Anudar, Yogo, Feyd Rautha, Just a word, Le chien critique, Célindanaé, Les lectures de Sophie, Les chroniques du chroniqueur.


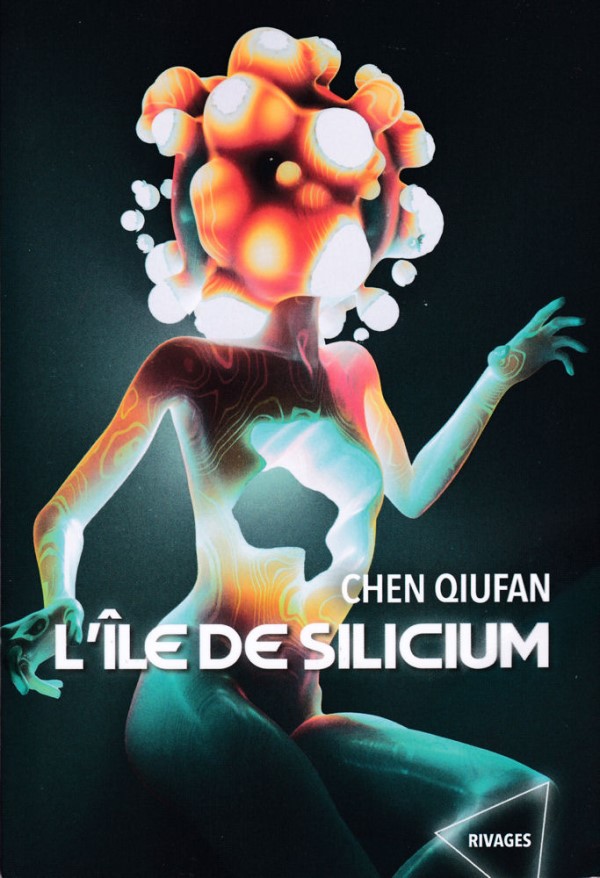
Malgré les quelques points que tu as soulevé, je suis curieuse de cette intrigue. J’espère que le livre ne me perdra pas trop, quand même ! J’ai besoin d’une précision, dans ta chronique, tu emploies les articles un ou une pour le nom « orque » : dans l’histoire, les deux sont utilisés ? Est-ce un choix de traduction ?
Il y a beaucoup de thématiques, mais au pire certaines ne sont qu’effleurées. C’est là un défaut, mais jamais l’auteur ne perd le lecteur dans un foisonnement d’idées étalées n’importe comment, tu peux être rassurée sur ce point.
Pour le mot « orque », tu fais bien de soulever la question. J’ai vérifié dans le dictionnaire, « orque » est un mot féminin. Je n’ai pas vérifié les occurrences du mot dans le roman (roman papier, c’est donc plus compliqué qu’en numérique…), mais j’imagine qu’il est correctement accordé. L’erreur vient donc de moi, j’ai corrigé mon article en conséquence. C’est ça aussi de lire trop de fantasy à la Tolkien ! 😀 Merci ! 😉
Je me demandais d’où venait le « ils » de Soq et tu as répondu à ma question même si je ne connaissais pas ce « they singulier » et comme toi j’aurais préféré le « iel » que l’on voit parfois. Peut être une volonté de se démarquer dans la traduction. Pour ma part, cela ne m’a pas posé plus de problème que ça.
Sinon. Nous sommes d’accord sur Qaanaaq comme personnage central de l’histoire et quel personnage.
Sam Miller est un auteur à suivre.
C’est toujours difficile de faire un choix de traduction, surtout sur le domaine des genres, chose que la langue française ne sait pas gérer correctement. Le « iels » aurait sans doute été bienvenu, mais ce pronom n’est pas encore officiellement passé dans la langue française, peut-être le choix a donc été fait de rester dans la langue « académique » ?
Pour le reste, oui Sam J. Miller a des choses à dire, et j’espère qu’il sera de nouveau traduit en français (ce sera déjà le cas pour un prochain Bifrost, avec une nouvelle).
Peut être que Gilles Dumay pourra nous éclairer sur le choix de la traduction de ce pluriel singulier ?!
Peut-être, en attendant j’ai trouvé ça sur le blog de Sophie : https://leslecturesdesophieblog.wordpress.com/2019/02/08/la-cite-de-lorque-sam-j-miller/#comment-2069
😉
Merci 😉
Il a l’air imparfait – plus ou moins selon les lecteurs – mais je garde complètement l’envie de découvrir cette ville. J’essayerai juste de ne pas être trop déprimé avant de me lancer. ^^
Cette ville est tout aussi déprimante que captivante, désolante et attirante. Le point fort du roman. Le reste n’est pas parfait mais se lit quand même très bien, et agit comme un avertissement. Parce que si on va dans cette direction…
Je l’ai dans ma PAL, du coup je n’ai lu qu’en diagonale pour capter ton impression générale…. et ça me tente pas mal !
Et ça vaut largement le coup de s’y pencher ! 😉
Je pense me laisser tenter et la mention du film Waterworld ^^ j’achète lol
Attention, il n’y a pas de Kevin Costner palmé luttant dans une mer chaude dans ce roman, c’est juste que ce monde où l’humanité a été obligée de construire sur la mer pour échapper à la montée des eaux m’y a fait penser. 😉
[…] Gromovar, Yogo, Le chien critique, Le Chroniqueur, Lorhkan, TmbM, Lune, Tigger […]