Le meilleur des mondes, de Aldous Huxley
Nouvelle incursion dans le monde des grands, que dis-je, des très grands classiques de la science-fiction. Mondialement connu, « Le meilleur des mondes » est devenu l’exemple-type des romans d’anticipation, faisant partie du grand trio du genre avec « 1984 » et « Fahrenheit 451 ».
Quatrième de couverture :
Bienvenue au Centre d’Incubation et de Conditionnement de Londres-Central. A gauche, les couveuses où l’homme moderne, artificiellement fécondé, attend de rejoindre une société parfaite. A droite : la salle de conditionnement où chaque enfant subit les stimuli qui plus tard feront son bonheur. Tel foetus sera Alpha -l’élite-, tel autre Epsilon -la caste inférieure. Miracle technologique : ici commence un monde parfait, biologiquement programmé pour la stabilité éternelle…
La visite est à peine terminée que déjà certains ricanent. Se pourrait-il qu’avant l’avènement de l’Etat Mondial, l’être humain ait été issu d’un père et d’une mère ? Incroyable, dégoûtant… mais vrai. Dans une réserve du Nouveau Mexique, un homme sauvage a échappé au programme. Bientôt, il devra choisir : intégrer cette nouvelle condition humaine ou persister dans sa démence…
Roman visionnaire par excellence
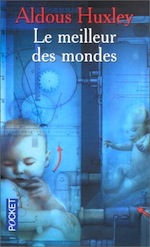 « Le meilleur des mondes » dépeint une société régie par l’eugénisme, la procréation ne se réalisant plus par voie naturelle mais uniquement dans des tubes à essais. Les individus sont ainsi prédestinés à certaines taches, ou à certaines situations sociales « grâce » à un dosage de différentes substances durant la maturation de l’embryon puis du foetus. Ainsi, les castes constituent le fondement même de cette société, depuis les Alphas, l’élite, ayant bénéficiée de la plus grande attention et de tous les soins pendant leur conception, jusqu’au Epsilons, en bas de l’échelle, attardés mentaux servant aux plus basses taches manuelles, qui ont vu leur évolution stoppée et/ou retardée à l’aide de différents produits chimiques, et qui sont souvent des clones répétés à l’envi d’un même individu.
« Le meilleur des mondes » dépeint une société régie par l’eugénisme, la procréation ne se réalisant plus par voie naturelle mais uniquement dans des tubes à essais. Les individus sont ainsi prédestinés à certaines taches, ou à certaines situations sociales « grâce » à un dosage de différentes substances durant la maturation de l’embryon puis du foetus. Ainsi, les castes constituent le fondement même de cette société, depuis les Alphas, l’élite, ayant bénéficiée de la plus grande attention et de tous les soins pendant leur conception, jusqu’au Epsilons, en bas de l’échelle, attardés mentaux servant aux plus basses taches manuelles, qui ont vu leur évolution stoppée et/ou retardée à l’aide de différents produits chimiques, et qui sont souvent des clones répétés à l’envi d’un même individu.
Mais ce n’est pas tout. Une fois nés, le conditionnement est roi. Ainsi, les enfants sont abreuvés à longueur de temps (jour et nuit) de phrases censées leur inculquer les valeurs de la société (« 62 400 répétitions font une vérité. »). Le libre arbitre n’existe plus, les idées reçues sont assimilées en tant que vérité absolue, la liberté de penser est inexistante (« Aimer ce qu’on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement. »).
Tout est fait pour que la société soit stable. Et tout est pensé dans ce but : la liberté sexuelle est plus qu’encouragée (notion reprise plus tard par Robert Silverberg dans « Les monades urbaines »), la notion de couple n’existe plus, de même pour la famille, l’amour est un sentiment oublié, les partenaires sont multiples, le conditionnement fait son effet et tout le monde est heureux dans sa vie personnelle comme dans son travail (« les gens sont heureux : ils obtiennent ce qu’ils veulent, et ils ne veulent jamais ce qu’ils ne peuvent obtenir. »). Et si parfois quelques désagrément surviennent, il existe le « soma », cette drogue légale et encouragée par l’état qui permet aux individus de plonger dans un état de béatitude, oubliant leurs menus soucis.
Cette société parfaite, pour garder cette stabilité, a annihilé tout ce qui peut amener les citoyens à penser : l’art est totalement contrôlé, la science également (« La vérité est une menace, la science est un danger public. »). Et comme le dit l’un de ses grands administrateurs : « L’Histoire, c’est de la blague ! ». Ainsi, la société, qui a oublié les religions que nous connaissons pour faire de Ford leur nouveau dieu et le taylorisme leur nouveau modèle, est comme figée, toujours pour garantir la plus parfaite stabilité.
Mais il existe un endroit ou tout est resté « à l’ancienne », une réserve située aux États-Unis dans laquelle les préceptes cités ci-dessus n’ont pas cours. Et quand un individu de cette réserve, issu d’une mère biologique, se retrouve confronté à cette société soit-disant parfaite, le choc des cultures n’en est que plus intense, et la froideur et l’inhumanité de ce système apparaissent au grand jour.
Je n’en dirai pas vraiment plus, ce roman est un classique et se doit d’être lu, de par son statut. Tout n’est pas non plus parfait, le style est parfois un peu vieillot (la traduction, qui n’a pas changé depuis l’origine, dans les années 40, mériterait sans doute un petit dépoussiérage), et si la première partie ma passionné (description plutôt complète du « meilleur des mondes »), j’avoue avoir eu un peu plus de mal avec la deuxième partie (confrontation du « sauvage » avec le « meilleur des mondes »).
« Le meilleur des mondes » reste malgré tout un roman étonnant, et surtout visionnaire, à travers toutes ses théories génétiques, allant du clonage à la manipulation des ovules, des gamètes et des embryons (alors qu’écrit en 1931, la génétique n’en était encore qu’à ses balbutiements), ou bien à travers ses théories sociales (la stabilité sociale est-elle compatible avec la vérité et le libre-arbitre ? Le bonheur de la société peut-il se passer d’éthique ? Doit-il forcément passer par la manipulation des masses ?)
Chronique réalisée dans le cadre du challenge « Les chefs d’œuvre de la SFFF » de Snow.


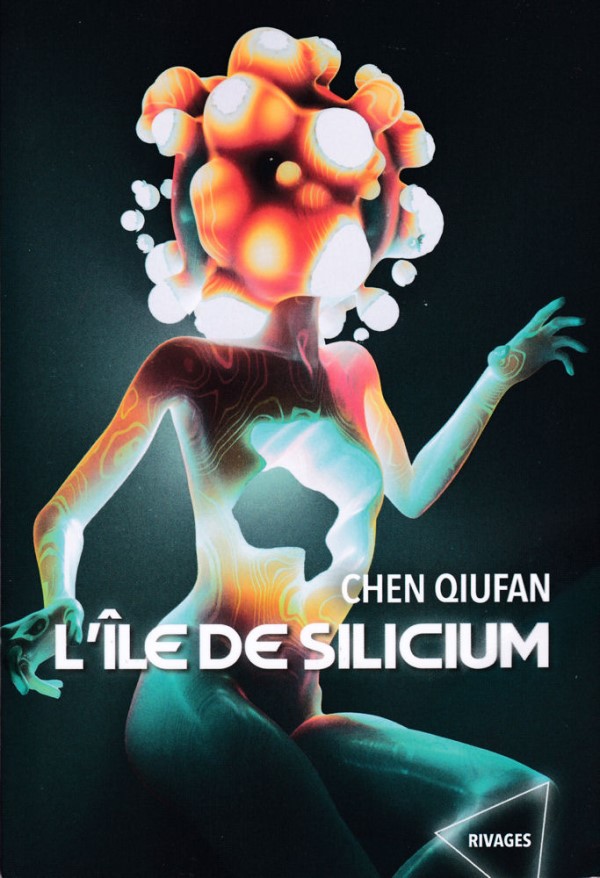
Entièrement d’accord avec toi. J’ai aussi trouvé le bouquin assez froid et austère malgré les thèmes traités et la profondeur de la réflexion. Et c’est vrai que du point de vue scientifique Huxley est extrêmement avancé, d’autant plus si on considère son époque.
Il y a aussi le personnage de Bernard qui est intéressant. Il met en valeur ces faux opposants au système qui le sont par frustration plus que par conviction. C’est son exclusion de la société qui l’a poussé à la détester, exactement à l’opposé de son ami.
Disons que les thèmes abordés, et l’anticipation menée par l’auteur sont passionnants, le traitement « romanesque » un peu moins.
C’est vrai que le personnage de Bernard est intéressant. J’ai cru que la confrontation avec la « machine sociétale » allait venir par lui, avant de comprendre ses motivations… Les noms des personnages sont par ailleurs assez représentatif de l’époque, et de la situation politique d’alors : Marx, Lénina, etc…
Une vraie beauté le design de ce site. J’adore aussi le contenu 🙂
[…] milliards de tapis de cheveux, A la Poursuite des Slans, Nouvelles, tome 1, Chroniques Martiennes, Le Meilleur des Mondes, [CHALLENGE TERMINÉ] – Mélisende : Des Fleurs pour Algernon, La Guerre des Mondes, Elric des […]